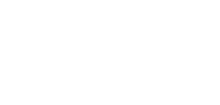[APPEL D’OFFRE] – Recrutement d’un.e consultant.e – Évaluation finale du projet Citoyennes Engagées (Renforcer le pouvoir d’agir des femmes – 2021-2024)
PREAMBULE :
Agir ensemble pour les droits humains, ONG basée à Lyon, a engagé en novembre 2021 un projet visant à renforcer le pouvoir d’agir des femmes au Gabon pour une meilleure application de leurs droits et réduire les inégalités femmes-hommes, à travers :
- des actions de diffusion d’informations accessibles pour soutenir la revendication et l’application des droits des femmes ;
- des actions de renforcement d’une sélection d’acteur.rice.s dans leur capacité à intervenir en faveur des droits des femmes.
C’est dans ce cadre qu’Agir ensemble pour les droits humains recherche un.e consultant.e pour réaliser l’évaluation externe de ce projet.
Cette évaluation finale est prévue à l’issue du projet : elle portera sur la mise en œuvre globale de l’action et de ses activités (aboutissements, leçons apprises, acquis en renforcement organisationnel, institutionnel et de capacités), sur la mise en réseau des différents acteur.ice.s, ainsi que sur la diffusion d’informations vulgarisées relatives aux droits des femmes. L’évaluation s’appuiera sur la lecture des différents rapports et sur des entretiens en présentiel ou en distanciel avec les bénéficiaires et porteur.euse.s du projet.
L’évaluation vise à analyser l’ensemble du projet, à mesurer l’impact des actions mises en œuvre, et à faire émerger les leçons apprises des 3 années du projet, ceci dans un objectif de redevabilité interne de la qualité de l’intervention.
CONTEXTE :
L’action est intervenue au cours de la décennie de la femme gabonaise (2015-2025), une stratégie nationale décrétée par l’ancien Président de la République, Ali Bongo Ondimba. La prise en compte des problématiques liées au genre et à la promotion des droits des femmes apparaissait comme prioritaire pour le développement du pays, et a également abouti à un Plan décennal pour l’autonomisation de la femme gabonaise, dont l’objectif est de « Contribuer à l’amélioration significative des conditions de vie des femmes et filles gabonaises à l’horizon 2025, en favorisant leur accès équitable aux droits, aux ressources et aux facteurs de production nécessaires à leur autonomisation intégrale par le biais des politiques et programmes mis en œuvre dans le cadre du développement national ». Plusieurs dispositifs, services et lois ont ainsi été déployé.e.s conformément au premier objectif spécifique de ce plan décennal visant à « Renforcer le Cadre juridique relatif aux droits des femmes et des filles gabonaises et favoriser l’amélioration de leur accès aux services judiciaires et à la protection juridique ».
Aujourd’hui, le gouvernement de transition qui fait suite au coup d’État du 30 août 2023 ne semble pas se positionner en matière de promotion et d’initiatives en faveur de l’application des droits des femmes dans le pays, peut-être afin de marquer la rupture avec les autorités précédentes. L’avenir des dispositifs de prise en charge préexistants et les futures initiatives en la matière semblent incertain.e.s.
Indépendamment de ce contexte, les droits des femmes sont mis à mal au Gabon malgré la promulgation de plusieurs lois, dont certaines relativement récentes, modifiant les codes civil, pénal et du travail (lois 004/2021, 005/2021, 006/2021 et 022/2021). La majorité de la population gabonaise n’est pas au fait des changements législatifs, les pesanteurs socioculturelles sont toujours prégnantes et les femmes ne sont pas suffisamment outillées pour faire respecter leurs droits. Pour y remédier, il est nécessaire d’identifier les acteur.rices, dispositifs, démarches et outils utiles à la promotion et la défense des droits des femmes ce qui est pour l’heure un défi. Par ailleurs, les institutions, prestataires de services et médias ne sont pas constant.e.s ni toujours coordonné.e.s dans leurs actions et n’offrent pas une diffusion assez large pour fournir des informations à jour et précises sur l’ensemble du territoire. Les organisations de la société civile (OSC) œuvrant pour l’application des droits des femmes existent, mais sont relativement faibles et nécessitent souvent d’être renforcées, outillées et accompagnées, afin de pouvoir réaliser pleinement leur mandat.
OBJECTIFS DU PROJET :
Le projet Citoyennes engagées a pour but de renforcer le pouvoir d’agir des femmes au Gabon pour une meilleur application de leurs droits et réduire les inégalités femmes-hommes (OG). D’une part, en facilitant l’accès à des informations utiles pour les détenteur.rices de droits et les intervenant.es dans le secteur des droits des femmes (OS1), et d’autre part, en renforçant une sélection d’acteur.rices dans leur capacité à intervenir en faveur des droits des femmes (OS2).
Il vise ainsi à mettre à disposition de toutes et tous des informations actualisées et vulgarisées au sujet des droits des femmes au Gabon et des diverses formes de violences basées sur le genre (VBG) qu’elles subissent en précisant les leviers juridiques et les peines pour les auteur.ice.s. Les informations à diffuser ont également vocation à émerger d’études et enquêtes qui doivent produire des données actualisées là ou un déficit est constaté, ainsi qu’à l’issu de diverses rencontres et ateliers d’échanges regroupant une pluralité d’acteur.ice.s investis dans la cause des droits des femmes.
Le projet tend également à renforcer les capacités d’action et l’impact des OSC émergentes œuvrant pour les droits des femmes au Gabon et plus particulièrement l’un des partenaires du projet, le Réseau Femme Lève-Toi (ReFLeT) ; à développer des compétences stratégiques, financières, organisationnelles, de réseau et techniques, afin d’appliquer au mieux leurs mandats en faveur du respects des droits des femmes au Gabon.
D’une durée de 36 mois (novembre 2021 – novembre 2024), le projet est cofinancé par la Délégation de l’Union Européenne au Gabon Sao Tomé-et-Principe et la CEEAC (DUE), la fondation National Endowment for Democracy (NED), l’Agence Française de Développement (AFD) et l’Ambassade de France au Gabon et à Sao Tomé-et-Principe à travers le programme PISCCA (Projets Innovant des Sociétés Civiles et Coalitions d’Acteurs).
Le budget total du projet est de 429 906 €, financé à 69,78% par la DUE.
PARTIES PRENANTES :
Le bailleur principal : La Délégation de l’Union Européenne
Le partenariat entre l’Union européenne (UE) et le Gabon repose sur le dialogue politique, le commerce et l’aide au développement. Il résulte des accord de Cotonou qui encadre par ailleurs le soutien, y compris financier, de l’UE auprès des acteurs non étatiques.
Un nouveau projet financé par ce bailleur a vu le jour le 1er janvier 2024 (Agir Contre Toutes les Formes de Violences Basées sur le Genre – ACT-VBG) avec Agir ensemble en coordinateur et le ReFLeT et Initiative Développement comme co-demandeurs. Il s’inscrit dans la poursuite et l’approfondissement des actions initiées dans le cadre du projet Citoyennes engagées.
Les bailleurs secondaires : la fondation NED, l’AFD et l’Ambassade de France.
Le porteur du projet :
Agir ensemble pour les droits humains : Agir ensemble est une organisation de solidarité internationale française fondée en 1989. A travers des partenariats établis avec des associations locales dans des pays du Sud et de l’Est, elle soutient des actions de terrain de défense et de promotion des droits fondamentaux, renforce les capacités des acteurs locaux et vient en aide aux défenseur.euse.s des droits humains en danger. Au cours des dernières années, l’ONG a travaillé en partenariat avec plusieurs organisations de la société civile au Gabon, y compris le ReFLeT et Brainforest, les partenaires gabonais du présent projet dont Agir ensemble est le coordinateur.
Les co-demandeurs :
Initiative Développement : Initiative Développement (ID) est une ONG française régie par la loi 1901. Fondée en 1994 à Poitiers, elle a pour objet de renforcer le pouvoir d’agir des acteur.rice.s locaux.les (ONG, collectivités territoriales, associations locales) en vue d’assurer une réponse durable aux besoins de base des communautés défavorisées des pays du Sud. ID intervient dans 9 pays : Haïti, Bénin, Tchad, Congo-Brazzaville, Comores, Madagascar, Sénégal, Burkina-Faso et France. En partenariat avec Agir ensemble, elle a débuté des actions au Gabon. Elle mène aujourd’hui une vingtaine de programmes regroupés autour de 5 thématiques: « citoyenneté et territoires », « climat, énergie, forêt », « eau, hygiène,assainissement », « santé » et « éducation », à travers des financements de bailleurs publics (AFD, UE…) et privés.
Le Réseau Femme Lève-Toi (ReFLeT) : Bénéficiaire et partenaire partie-prenante de l’action. Le ReFLeT est une association gabonaise investie dans le champ des droits humains, qui repose sur près de 400 adhérents et une quarantaine de membres actif·ve·s. Il s’est donné pour mission de promouvoir le leadership, la participation politique et l’autonomisation des femmes en vue de leur pleine participation au développement du pays, de lutter contre les violences faites aux femmes, de promouvoir l’éducation à la citoyenneté. Il entretient des relations variées et est de plus en plus remarqué pour son expertise et la qualité de ses interventions. Dans le cadre du projet, le ReFLeT est le principal partenaire de mise en oeuvre, il exécute la majorité des dépenses, dispose de trois salariés pratiquement à temps plein sur le projet et la plupart des activités sont réalisées au sein de son siège.
Brainforest : Créée en 1998, Brainforest est une ONG de droit gabonais qui travaille sur la problématique Forêt – Environnement dans une double perspective d’appui sur le terrain et de suivi des politiques. Sa philosophie s’articule autour de la prise en compte de l’interdépendance dans l’analyse des problèmes environnementaux et sociaux, la participation des populations locales (Bantu et Communautés Autochtones « Pygmées ») aux divers processus favorisant la reconnaissance de leurs droits, la promotion du développement communautaire et la prise en compte des spécificités des Peuples Autochtones. Dans le cadre de ce projet Brainforest a notamment le rôle de faire bénéficier le consortium de son expertise pour la conduite de projets au Gabon et notamment en partenariat avec la DUE.
Les bénéficiaires finaux du projet :
La population du Gabon : En premier lieu les femmes et les filles détentrices des droits, Gabonaises ou non. Le droit à l’information n’est pas une réalité pour l’ensemble de la population ; surtout en ce qui concerne des informations fiables et actualisées. Il y a une large méconnaissance des lois, des recours et des sanctions applicables. Les victimes de violation des droits sont en général résignées : en demande pour trouver des soutiens, elles appréhendent mal leurs droits, n’ont pas toujours confiance dans les institutions et ne savent pas vers qui se tourner. Il leur faut des solutions concrètes, simples et bienveillantes, de proximité et/ou qui leur permettent de rester anonymes et en sécurité.
Les groupes cibles principaux :
Les organisations actuellement engagées ou intéressées par l’application des droits des femmes : Il s’agit d’OSC positionnées dans le soutien aux femmes ou qui interviennent directement auprès des femmes et/ou qui accompagnent leurs groupements. En l’absence de services publics adéquats, pourvus et étendus, ce sont principalement les OSC qui sont sur le terrain qui apportent des services aux femmes et les aident à faire valoir leurs droits.
A l’image du reste du mouvement associatif, les organisations de défense des droits des femmes rencontrent de nombreux défis : l’environnement n’est pas propice à leur déploiement, les capacités organisationnelles, institutionnelles et techniques des structures sont fragiles, et leur viabilité est faible. Le projet donne à ces organisations l’occasion : de se rendre davantage visibles (dans un répertoire en ligne et au cours des actions menées conjointement) ; d’attirer l’attention sur leurs contraintes et besoins (au cours des rencontres et lors des études/enquêtes) ; de disposer d’informations et ressources plus lisibles et plus vastes (contenus du site internet, paysage des appuis y compris à l’international, etc.) ; et de renforcer leurs capacités techniques et moyens d’action (via des formations et des alliances).
Un panel d’hommes et de femmes, sélectionnés dans les provinces d’intervention du ReFLeT et Brainforest : Un échantillon de personnes, bénéficiant déjà de l’appui des deux codemandeurs gabonais dans l’Estuaire, le Woleu-Ntem et la Ngounié, est impliqué directement dans la conception et l’exécution de plusieurs activités. Leur identification se fait sur une base volontaire. Leurs besoins sont ceux des bénéficiaires finaux, leurs contraintes sont les mêmes. Mais le projet leur donne directement la possibilité d’être les premier.ère.s acteur.rice.s des changements qu’ils.elles participent à définir. Leur aide pour mettre en œuvre diverses activités du projet et en bâtir les produits, les positionne comme des détenteurs.trices de droits en situation de proposer et élaborer des solutions qui non seulement leur sont profitables à titre personnel, mais sont également bénéfiques à bien d’autres dans leurs communautés respectives.
Les responsables des droits et autres parties-prenantes (partenaires institutionnels et économiques) : La collaboration des décideureuse.s économiques, des autorités locales (municipales, traditionnelles, religieuses…) et des fonctionnaires, est nécessaire pour faire évoluer la mise en œuvre des droits dans la pratique et amorcer des réflexions en ce sens. Les cibles prioritaires demeurent pour l’heure les acteur.ice.s qui interviennent directement dans la chaîne de l’orientation et la prise en charge (médicale, psychologique, judiciaire, sociale, etc) des victimes de violences sexistes. Ce sont les plus à même de pouvoir identifier lesdéfaillances, manquements et incohérences des lois qui régissent l’application des droits des femmes dans le pays.
Les codemandeurs locaux : Brainforest et plus particulièrement le ReFLeT sont parties-prenantes de l’action, mais également des bénéficiaires. Plusieurs activités visent directement à leur faire bénéficier d’actions de renforcement de capacités, d’ateliers d’échanges et de bonnes pratiques, de mise en réseau ou encore la maîtrise de l’approche orientée changement appliquée à la mobilisation sociale (AOC-MS). L’objectif demeure également d’accentuer la montée en compétence et la crédibilité du ReFLeT dans le cadre de son mandat, notamment via la planification et l’exécution de son renforcement organisationnel et institutionnel sur toute la durée du projet.
PRINCIPALES ACTIVITES DU PROJET :
Axe 1 : Faciliter l’accès à des informations utiles pour les détenteur.rices de droits et les intervenant.es dans le secteur des droits des femmes
Indicateur : Une information pertinente est disponible et facilement accessible pour soutenir la revendication et l’application des droits des femmes.
Afin de parvenir à cet objectif le projet entend tout d’abord mettre à disposition des populations un centre de ressources en ligne compilant une multitude de données juridiques au sujet des droits des femmes au Gabon en les vulgarisant. Un répertoire d’acteur.ice.s engagé.e.s en faveur des droits des femmes et une boîte à outil à disposition des OSC œuvrant sur le sujet doivent également voir le jour et être alimentés en continu. Les informations doivent être diffusées via des actions médiatisées au travers d’une campagne de sensibilisation numérique à l’aide du site internet (citoyennes-engagees.org), des réseaux-sociaux du projet et des différents partenaires. Enfin, d’autres actions doivent avoir lieu pour faire émerger de nouvelles connaissances et les partager au plus grand nombre comme des études et enquêtes qui doivent venir combler le déficit d’informations au sujet des droits des femmes et de leur application au Gabon. Des ateliers de réflexion doivent également avoir lieu régulièrement et regrouper différents acteur.ice.s de la société civile et expert.e.s, afin de faire émerger des bonnes pratiques et partager les connaissances nécessaires pour le respect des droits des femmes dans le pays.
Axe 2 : Renforcer une sélection d’acteur.rices dans leur capacité à intervenir en faveur des droits des femmes
Indicateur : Une sélection d’acteur.rice.s de la société civile gabonaise est renforcée dans sa capacité à accompagner durablement les femmes, plus particulièrement dans leurs droits économiques
Pour y parvenir le ReFLeT doit bénéficier d’un accompagnement dans le but d’être consolidé au travers d’un renforcement organisationnel et institutionnel (ROI) pour pouvoir accentuer son changement d’échelle, sa professionnalisation et donc d’en faire un acteur de premier plan en matière de leadership féminin et droits des femmes au Gabon. Pour ce faire, le ReFLeT doit définir et poursuivre un plan de renforcement de capacités (communication, droits humains, législation gabonaise en matière de droits des femmes, orientation des victimes de VBG etc) qui doit lui permettre d’atteindre ses objectifs. Les actions formatives doivent également avoir vocation à être partagées auprès des différents partenaires associatifs et opérationnels du ReFLeT. Le projet entend étendre au maximum le réseau du ReFLeT aux divers acteur.ice.s qui agissent pour l’application des droits des femmes dans le pays. Cela passe également par la collaboration avec des points focaux en provinces qui doivent relayer les activités et informations vulgarisées produites dans le cadre du projet.
Enfin, le projet entend également transmettre pour la première fois au Gabon l’approche orientée changement appliquée à la mobilisation sociale (AOC-MS) aux partenaires locaux que sont le ReFLeT et Brainforest. Cette approche place l’acteur.rice au cœur des dynamiques de développement, l’objectif étant d’accompagner ces dernier.e.s dans l’amélioration d’une situation donnée, à partir de changements d’habitudes et de comportements. Deux dispositifs, un par partenaire, doivent donc être conduits en faveur des droits des femmes.
DESCRIPTION DU TRAVAIL D’EVALUATION
Le travail d’évaluation comprendra les volets ci-dessous :
1. Établissement d’un bilan global du projet évalué
Le.la consultant.e ou le duo de consultant·e·s devra établir un bilan global et objectif des actions du projet depuis son démarrage. Cette étape doit lui permettre de disposer d’une connaissance précise et détaillée du projet, de son évolution et de son contexte. A cet effet, il ou elle devra notamment :
– Rassembler et consulter toutes les informations et tous les documents relatifs au projet évalué, et étudier le cadre logique de l’intervention (finalité, objectifs spécifiques, réalisations, indicateurs de suivi et hypothèses critiques) de manière à en acquérir une bonne connaissance. Les documents à consulter seront disponibles auprès d’Agir ensemble, d’Initiative Développement, du Réseau Femme Lève-Toi (ReFLeT) et de Brainforest.
– Conduire des entretiens avec les personnes impliquées ou ayant été impliquées dans le projet.
– Recueillir les témoignages des personnes et structures locales ayant contribué à la réalisation du projet et des personnes ayant bénéficié du projet.
2. Conduite d’une analyse évaluative
A partir des constats et des informations disponibles, le.la consultant.e devra évaluer la performance du projet au regard des cinq critères préconisés par le Comité d’aide au développement de l’OCDE : pertinence, efficacité, efficience, impact, viabilité. Ainsi, des questions évaluatives ont été identifiées. Elles pourront être précisées par le·la consultant·e dans son offre ou lors de la réunion de cadrage si cela est pertinent. L’évaluateur.ice devra par ailleurs axer ses recommandations dans une perspective d’évaluation des changements opérés au cours du projet, et de réflexion sur les pistes d’amélioration et adaptations à prendre en compte notamment pour la mise en œuvre du projet ACT-VBG.
Questions évaluatives :
REDEVABILITE EXTERNE
– Dans quelle mesure les objectifs du projet sont-ils atteints à la fin du projet ? Proposer une analyse croisée des résultats/effets du projet et des moyens mobilisés (efficacité,efficience)
– De quelle manière le projet a-t-il permis de renforcer le pouvoir d’agir des femmes au Gabon ? Quels ont été les freins/limites et succès ? (impact)
– Le projet a-t-il eu des effets positifs et/ou négatifs non prévus sur les bénéficiaires ? Si oui, lesquels ? Les effets négatifs ont-ils pu être atténués ? Si oui, comment ? (impact, durabilité)
REDEVABILITE INTERNE
– Dans quelle mesure le projet a-t-il permis de répondre aux besoins initiaux des groupes cibles/bénéficiaires et au contexte de mise en œuvre ? (Pertinence et efficacité)
– Le projet s’est-il inséré de façon optimale dans son environnement ? (cohérence)
– Les acteur.ice.s ont-iels utilisé les ressources de façon optimale ? (efficience)
Axes transversaux :
– Genre : Comment la notion de genre est-elle prise en compte dans les objectifs, la stratégie, et les activités du projet Citoyennes Engagées?
– Mise en réseau : Est-ce que les OSC ont pu développer des liens porteurs et de nouvelles perspectives grâce à la mise en réseau réalisée (notamment au profit du ReFLeT) ? (efficacité, pertinence)
– Redevabilité : Dans quelles mesures le projet Citoyennes Engagées a mis en place des mécanismes de redevabilité envers les publics cibles/bénéficiaires du projet et des partenaires ? Ces mécanismes sont-ils efficients ?
– Information / sensibilisation : Quel est l’impact et la portée des actions de sensibilisation réalisée auprès des cibles du projet ? (impact)
– Renforcement organisationnel et institutionnel : Dans quelles mesures le ROI réalisé par Agir ensemble a-t-il permis de consolider le ReFLet ? (impact)
– Renforcement de capacités : Évaluer la pertinence, l’efficience et la portée des actions de renforcement de capacités effectuées auprès des bénéficiaires.
La démarche d’évaluation sera ponctuée par trois temps forts :
– Des entretiens avec les membres des différents partenaires du consortium, et une enquête auprès de bénéficiaires directs et indirects du projet, ainsi que de certaines parties prenantes extérieures impliquées dans le déroulement de l’action devront être menés. La réalisation d’une visite terrain par l’évaluateur.ice à Libreville au Gabon est encouragée.
– L’évaluateur.rice (ou le duo d’évaluateur.ice.s) animera un atelier participatif (en présence des partenaires opérationnels et financiers du projet) présentant les premières conclusions/recommandations de l’évaluation du rapport intermédiaire. Ce sera également l’occasion d’approfondir certains points avec l’ensemble des parties prenantes du projet et de recueillir leurs retours.
– La restitution finale dans les locaux d’Agir ensemble si possible (sinon en visioconférence). L’évaluation finale veillera notamment à mesurer la pertinence de la proposition par rapport au contexte et aux besoins des acteur.ice.s ; la cohérence des actions proposées ; l’efficacité des activités menées ; leur efficience au regard des moyens mobilisés ; les résultats obtenus, et leur viabilité. Elle portera sur la mise en œuvre globale du projet. L’objectif de l’évaluation et de l’atelier sera d’ajuster, d’intégrer et de partager les leçons apprises pour la poursuite des projets existants (ACT-VBG notamment) et la construction des projets post-Citoyennes engagées.
MODALITES DE L’EVALUATION
L’évaluation se fera à distance (ou en présentiel si consultant.e.s local.e/aux), avec une visite potentielle à Libreville au Gabon auprès des bénéficiaires et partenaires de mise en œuvre du projet.
Démarche méthodologique :
L’approche se veut participative avec des consultations collectives et individuelles. Pour ce faire, l’évaluation s’appuiera sur :
– La documentation disponible auprès de chaque partenaire (rapports, comptes-rendus d’activités, contenus de sensibilisation, études, rapports de mission…) ;
– Des entretiens avec les principaux responsables de la mise en œuvre et du suivi du projet (l’équipe d’Agir ensemble, d’ID, du ReFLeT et de Brainforest, les prestataires) ;
– Des entretiens avec les partenaires techniques et financiers du projet, notamment ceux présents au Gabon et en lien avec les équipes locales (DUE et Ambassade de France au Gabon)
– Des entretiens avec les bénéficiaires et les groupes-cibles (femmes, organisations partenaires, points focaux…).
Tout au long du processus d’évaluation, des points réguliers sont organisés avec les équipes projet, afin de restituer les avancées et d’obtenir les validations nécessaires.
En cas de force majeure, liée notamment à l’évolution de la situation sécuritaire à Libreville, des entretiens pourront être prévus de façon dématérialisée, par visioconférence.
Dans sa proposition technique, le.la consultant.e ou le duo de consultant·e·s devra présenter la méthodologie envisagée, ainsi que les techniques et outils de recueil et d’analyse des données.
Durée de l’évaluation :
La prestation pour la réalisation de cette évaluation aura lieu entre juin et octobre 2024.
La prestation débutera après la signature du contrat entre le.la consultant.e ou le duo de consultant·e·s et Agir ensemble. Elle inclut notamment une réunion de lancement, une mission de terrain (si possible), une réunion intermédiaire (en présentiel ou en visioconférence), un atelier avec les parties prenantes (en visioconférence) et une restitution finale en octobre 2024 (en phygital dans les locaux d’Agir ensemble).
Calendrier prévisionnel/indicatif :
23 juin 2024 : Date limite de réception des candidatures.
Fin juin jusqu’à début juillet 2024 : Sélection de l’évaluateur ; réunion de cadrage et production d’un document de programmation des activités d’évaluation.
De juillet à mi septembre 2024 : Réalisation de l’étude, enquête sur le terrain et entretien en visioconférence avec les différentes parties prenantes et bénéficiaires.
Mi septembre 2024 : Remise du rapport provisoire d’évaluation et réunion de présentation des résultats avec Agir ensemble pour les droits humains.
Fin septembre 2024 : Animation d’un atelier de restitution et d’échange autour des premiers résultats.
Mi octobre 2024 : Remise du rapport final.
Fin octobre 2024 : Réunion de restitution de l’étude.
Livrables attendus :
Il sera demandé à l’évaluateur.rice de fournir :
– Un rapport de cadrage (ou note de démarrage) présenté à Agir ensemble mi-juillet 2024. Il fera le point des premières investigations sur la base de la revue documentaire et des premiers entretiens. Il inclura : les questions et hypothèses qui seront traitées ; le planning prévisionnel ; les entretiens prévus, la méthodologie employée.
– Un rapport provisoire devra être disponible au plus tard mi-septembre 2024. Des commentaires seront faits et transférés à l’évaluateur.rice pour considération dans la rédaction du document final. Il fera l’objet d’une première restitution avec l’ensemble des parties prenantes lors de l’atelier de fin septembre 2024.
– Un rapport final intégrant les remarques émises lors des réunions de restitution. Il devra être achevé et disponible avant le 15 octobre 2024. Il sera transmis en version électronique (format Word et PDF). Le rapport devra comprendre à minima :
1 – Un rapport principal comprenant : un rappel rapide des termes de référence : (TDR) et de la méthodologie employée ; la liste des personnes rencontrées et des lieux visités ; une bibliographie éventuelle ; le déroulement du projet et les caractéristiques principales qui y sont liées ; les observations et résultats de l’évaluation, tels que définis dans les TDR ; l’analyse de l’impact et de la perception par les bénéficiaires, par les institutions et autres acteur.ice.s impliqué.e.s dans le secteur ; des perspectives et conditions de pérennisation du projet ;
2 – Le tableau des indicateurs mis à jour présentant les valeurs atteintes par le projet ;
3 – Les réussites clés du projet ainsi que les difficultés les plus significatives ;
4 – Une analyse des effets atteints au bout de 3 ans en termes d’évolution des droits des femmes d’une part et de renforcement des OSC d’autre part ;
5 – Une synthèse/résumé exécutif (4 pages maximum) reprenant, après une présentation générale rapide, les principales conclusions et recommandations.
PROFIL DE L’EVALUATEUR.RICE :
Les compétences requises pour réaliser cette évaluation sont :
– Connaissance et expérience professionnelle en matière d’évaluation
– Expérience en matière de coopération au développement
– Maîtrise du contexte politique, juridique et associatif du Gabon
– Maîtrise des enjeux liés aux droits des femmes et aux Violences Basées sur le Genre (VBG)
– Connaissance des mécanismes de financements de l’UE, notamment le financement des projets terrain
– Des connaissances sur les différents types d’activités du projet sont un plus (ROI, AOC, actions de sensibilisation, renforcements de capacités)
L’évaluation sera menée par un.e expert.e ou un duo d’expert.e.s ayant une expérience confirmée dans l’évaluation de projets internationaux et une excellente connaissance des problématiques relatives à l’application des droits des femmes en Afrique centrale et au Gabon en particulier. Une bonne compréhension des réalités sociopolitiques de la région et du pays est indispensable.
Le.la consultant.e ou le duo de consultant.e.s devra avoir conscience que la prestation attendue implique un engagement sur plusieurs mois pour la réalisation du rapport final d’évaluation.
Le.la consultant.e ou le duo de consultant.e.s souhaitant répondre à cet appel d’offre devra préciser les modalités envisagées pour assurer une appréciation systématique et objective de la mise en œuvre des activités au cours du projet.
Modalités de réponse et critères de sélection du.de la prestataire :
Les prestataires intéressé.e.s enverront une proposition constituée des éléments suivants :
– Un CV de l’évaluateur.rice ou du duo de consultant.e.s et, le cas échéant, d’une présentation de la société ou de l’organisation dont il ou elle dépend (10 pages maximum) ;
– Une proposition technique décrivant notamment la compréhension de la mission (2 pages maximum), la démarche méthodologique proposée pour atteindre les objectifs (4 pages maximum), un chronogramme indicatif et les résultats attendus de l’évaluation ;
– Une offre financière comportant le budget global (Hors Taxe et Toutes Taxes Comprises) et les prix détaillés (honoraires, indemnités journalières, transports…) ;
– La disponibilité du.de la consultant.e ou du duo de consultant.e.s durant les mois de juin à octobre 2024.
Le devis ne pourra pas dépasser le montant total de 11 000 euros TTC pour l’ensemble de la prestation. Ce budget inclut les frais de consultance, de transport et de séjour pour les déplacements sur le terrain qui sont directement pris en charge par l’évaluateur.rice ou le duo d’évaluateurs.trices.
La sélection de l’expert.e ou du duo d’expert.e.s se fera sur la base des critères d’évaluation suivants :
– Exposé de la problématique et compréhension du sujet
– Démarche méthodologique proposée
– Qualifications, expériences et compétences des expert.e.s
– Expériences de la zone et de la problématique du projet à évaluer
– Détail des prix et coûts des différentes prestations
– Chronogramme de réalisation de l’ensemble des prestations.
Les propositions sont à adresser par mail aux deux adresses suivantes au plus tard le 23 juin 2024 sous la référence CE\EVAL\2024 :
l.zannier@aedh.org
c.martinez@aedh.org
TERMES DE REFERENCES
Vous souhaitez déposer un appel d’offre ?
Déposez vos appels d'offres pour vos recherches de prestations visant à renforcer votre organisation, faciliter vos projets...
Déjà inscrit ?
L’ABC des prestataires
Plus de 50 prestataires référencés dans notre base !