Evaluation Finale Projet AFD en Haïti
Termes de référence pour le recrutement d’un consultant chargé de l’évaluation finale
du projet « Contribuer à l’amélioration de la prise en charge de la douleur et des soins palliatifs en Haïti »
1. Cadre de la consultation
Objet consultation : évaluation du projet « Contribuer à l’amélioration de la prise en charge de la douleur et des soins palliatifs en Haïti »
Lieu d’affectation : Haïti — Ouest (Port-au-Prince, Delmas), Nord (Cap-Haïtien) – Sud, Sud-Est, Nord-Est
Autorité contractante : Douleurs Sans Frontières
Période de la consultation prévu : avril – mai 2025
Bailleur : Agence Française du Développement
2. Présentation de Douleurs Sans Frontières
En général
DSF est une ONG de solidarité internationale experte dans la prise en charge de la douleur et le suivi des patients en fin de vie qui travaille auprès de populations les plus vulnérables depuis près de 25 ans. DSF a développé une approche transversale et holistique des patients qui privilégie l’éthique et la qualité des soins par l’accueil, la bienveillance, la pluridisciplinarité, la communication avec le patient et ses proches ou encore la coordination entre les services pour un parcours de soins plus adapté.
En Haïti
DSF est intervenue en Haïti à la suite du séisme de 2010. Sa légitimité d’intervention réside notamment dans le fait que DSF a répondu aux besoins exprimés par des soignants qui se sentaient démunis face à la douleur chronique et qui souhaitaient un renforcement de cette prise en charge ainsi que le développement des soins palliatifs pour les pathologies incurables. C’est pourquoi, DSF a mis en œuvre une approche intégrée de la douleur en proposant des espaces de soins et d’apprentissage pour les soignants, de la formation initiale et continue – notamment sur l’importance de l’accueil des patients et les traitements innovants et peu onéreux. Ainsi, dans le cadre de ce projet, DSF travaille avec l’État haïtien, les professionnels de santé et la société civile pour une meilleure compréhension des impacts de la douleur sur la société et plaide pour la reconnaissance de l’importance de la prise en charge de la douleur et des soins palliatifs, l’intégration des formations sur la douleur/SP dans le cursus des professionnels de la santé et la mise à disposition de traitements de la douleur variés et adaptés au contexte haïtien.
DSF a ainsi participé activement à l’implantation d’un service de prise en charge de la douleur (Unité Douleur – UD) à l’Hôpital Universitaire de l’Etat d’Haïti (HUEH) en 2011. En septembre 2012, avec un financement du réseau Caritas, DSF a lancé un projet d’appui institutionnel à la mise en place d’un dispositif accessible de PEC de la douleur à l’HUEH. Durant 3 ans DSF a donc accompagné l’UD dans sa reconnaissance institutionnelle, sa collaboration avec les services de l’hôpital et à l’élaboration de son projet de service. En parallèle, de nombreuses activités de formation, de sensibilisation et d’étude ont été menées avec des acteurs institutionnels et associatifs (dont les principaux sont la SHA, la FMP-UEH, la FSIP, la FOKAL et la DPM-MT). Ensuite, en 2015, DSF a déposé un projet (première phase) à l’AFD qui a permis à l’UD de l’HUEH de proposer une offre pluridisciplinaire de soins[1]et de développer les collaborations avec les autres services de l’HUEH. Dans le projet, en 2018 une UD a été installée aussi à l’Hôpital Universitaire de la Paix (HUP) grâce à la mobilisation des médecins, résidents et de la direction médicale de l’hôpital. En parallèle, les activités de formation et de plaidoyer ont permis de créer des liens importants avec des structures de soin, des sociétés médicales, des ONG, des écoles et des universités. Dans le cadre de la phase 2 du projet AFD le renforcement des dispositifs de prise en charge de la douleur au sein des hôpitaux partenaires s’est accompagné avec la réalisation de formation initiales en prise en charge de la douleur et soins palliatifs (faculté de médecine et sciences infirmières de la capitale), formation continues diplômantes (deuxième promotion du Diplôme Universitaire en algologie en format hybride) et non (hôpital Trauma MSF de Tabarre, centre Covid MSF de Cite Soleil). Des outils de communication ont été élaborés et diffusés aux professionnels et non professionnels, notamment « le guide pour les aidants » ainsi que le « guide des ASCP » en partenariat avec la SOHAD.
3. Contexte
Contexte d’intervention et présentation du projet à évaluer
Si la première phase du projet (2016-2019) réalisée par DSF et soutenue par l’Agence Française du Développement a permis de renforcer les liens avec les principaux partenaires de DSF et d’entamer de nouvelles collaborations pour instituer et généraliser la culture de la prise en charge de la douleur en Haïti et renforcer la qualité du système de santé haïtien, la deuxième est née du besoin de permettre aux partenaires de s’approprier du domaine de l’algologie et d’introduire les soins douleur et palliatifs dans leur pratique. L’objectif de la deuxième phase était de renforcer la stratégie de sortie du projet par le renforcement de l’association haïtienne de la douleur (SOHAD), le compagnonnage, la standardisation des formations et des soins douleur et palliatifs (curriculums de formation, protocoles de soins, fiches de référencement et outils, etc.) et le plaidoyer pour une plus grande reconnaissance de la douleur et de son appropriation par l’Etat haïtien et la société civile. Pour la phase 3, DSF souhaite contribuer à l’amélioration de l’accès à la PEC de la douleur et des soins palliatifs pour les usagers du système de santé haïtien par le biais du renforcement des services d’algologie existants et des formations proposées aux étudiants et aux soignants dans ce domaine, ainsi que par une diffusion à une plus large échelle de la culture de la PEC de la douleur en Haïti. Il s’agira dans cette phase conclusive de travailler à la capitalisation des bonnes pratiques identifiées et de renforcer les compétences des partenaires locaux afin de faciliter leur autonomisation en vue de la pérennisation des activités en lien avec la douleur dans le pays.
La confiance de ses partenaires et l’investissement des professionnels de santé sensibilisés a permis à DSF d’identifier des actions pertinentes et adaptées aux besoins et aux attentes des acteurs de la santé, des patients et de leurs aidants. L’intérêt grandissant des pouvoirs publics, l’implication des responsables de structures de soins et des universités et écoles, ainsi que le soutien des patients et des populations sensibilisées ont convaincu DSF de continuer d’élargir ses activités formatives et de sensibilisation dans d’autres départements.
L’évaluation finale de la deuxième phase du projet (2019-2023), réalisée en mai 2022, a d’ailleurs souligné l’opportunité de pérennisation des modules de formation sur la PEC de la douleur dans les curriculums de formation grâce aux travaux d’accréditation des universités, qui expriment un intérêt croissant pour ces modules et une autonomie dans leur intégration aux cursus : « Durant l’évaluation, l’ensemble des professionnels de la SOHAD et des Uds mettent en avant leur intérêt pour les soins palliatifs ; en effet, au-delà des modules de sensibilisation aux soins palliatifs dans le cadre du DU, les professionnels des Uds sont confrontés à des patients en fin de vie et ont mis en place des protocoles et outils tant pour les patients que leurs aidants. Ainsi, la perspective de développer un DU Soins palliatif dans le cadre d‘un nouveau projet est pertinent. Lors des entretiens évaluatifs, l’Université Notre Dame a exprimé son intérêt à s’engager dans une telle dynamique. » Les recommandations de l’évaluateur ont porté sur l’importance de :
- Renforcer l’appui à la SOHAD afin que l’association renforce ses actions (actions de sensibilisation et de plaidoyer) et assure sa viabilité (convention de partenariat)
- faciliter un rapprochement entre les directeurs d’établissement hospitaliers et le directeur général de la santé afin d’intégrer les UD dans l’organigramme des hôpitaux et planification ministérielles ;
- pérenniser les formations initiales et continues en douleurs, en favorisant l’intégration des modules douleurs dans les curricula de formation via un processus d’accréditation
- renforcer les actions de soutien psychologique aux soignants via la formation à la « 1ère prise en charge psychologique »
- assurer le travail de capitalisation et d’accompagnement des acteurs, notamment par la création d’un poste supplémentaires avec des compétences médicales.
Résumé du projet
4.Objectifs de l’évaluation
L’objectif de cette évaluation est d’analyser la qualité des différentes activités réalisées par DSF dans le cadre du projet ici présenté en vue d’apprécier leur pertinence, efficacité, efficience et viabilité. Elle a également pour but d’assurer la redevabilité due aux bailleurs et aux bénéficiaires, de tirer des enseignements, de capitaliser sur les bonnes pratiques et de formuler des recommandations d’ajustements éventuels pour la consolidation et la pérennisation des acquis. Cette évaluation permettra aussi de mieux identifier les bonnes pratiques développées au long du projet, d’alimenter le processus de capitalisation, d’identifier les points faibles et les pistes sur lesquelles il serait important de travailler par la suite. Ce qui se traduira par :
- Un bilan des activités menées
- Une valorisation des résultats atteints
- Une identification des leçons apprises
Une production de recommandations qui puissent être utiles et pertinentes pour identifier les points à approfondir et développer dans le futur.
5.Méthodologie
Le travail d’évaluation comprendra les volets ci-dessous :
5.1 Etablissement d’un bilan global du projet évalué
Le consultant devra établir un bilan global et objectif des actions du projet en cours. Cette étape doit lui permettre de disposer d’une connaissance précise et détaillée du projet, de son évolution et de son contexte. A cet effet, il devra notamment :
– Rassembler et consulter toutes les informations et tous les documents relatifs au projet évalué, et étudier le cadre logique de l’intervention (finalité, objectifs spécifiques, réalisations, indicateurs de suivi et hypothèses critiques) de manière à en acquérir une bonne connaissance. Les documents principaux à consulter seront fournis par la coordination du projet.
– Conduire des entretiens avec les personnes impliquées ou ayant été impliquées dans la conception, la gestion et la supervision du projet.
5.2 Conduite d’une analyse évaluative
A partir des constats et des informations disponibles, le consultant devra évaluer la performance du projet à partir des cinq critères suivants : pertinence, efficacité, efficience, impact, viabilité. Pour chacun de ces critères, des pistes d’évaluation sont préconisées ci-dessous. Il reviendra au consultant de les préciser et de les compléter en ayant à l’esprit qu’il s’agit d’une évaluation finale portée principalement sur les cinq critères susmentionnés. Le consultant est toutefois encouragé à adopter une approche mixte, quantitative et qualitative afin de produire une analyse plus fine des enjeux véhiculés par la mise en œuvre du projet. Les principaux bénéficiaires du projet à prendre en compte (soignants, patients, étudiants) devront être interrogés au cours de l’enquête afin de produire une analyse capable d’intégrer les vécus, les bénéfices apportés par les interventions ainsi que les possibles besoins non satisfaits ou inexprimés.
Avant de conduire l’analyse, il est demandé au consultant de présenter de façon détaillée la méthodologie proposée, en tenant en compte de la modalité de réalisation de l’évaluation (présentiel ou hybride) (cf. Livrables attendus).
Pertinence La pertinence examine le bien-fondé de l’action conduite au regard des objectifs et des enjeux déterminés au départ en rapport avec les besoins et problématiques identifiés. A ce titre, le consultant examinera la correspondance du projet avec :
- La pertinence et la qualité de la conception du projet au regard des problèmes, contraintes et besoins réels identifiés dans le domaine de la sante dans le contexte haïtien ;
- La pertinence des stratégies développées par DSF dans la mise en œuvre du programme pour l’atteinte des améliorations visées ;
- Les besoins et attentes réelles des bénéficiaires (patients et professionnels de santé) ;
- L’inscription des actions menées dans le cadre institutionnel nationale de la santé (accès aux services, programmes nationaux, formation des professionnels, etc.) ;
- Les stratégies et interventions des autres parties prenantes, notamment les structures de santé, les institutions de formation et les associations et sociétés médicales partenaires.
Cette analyse sera complétée par une appréciation de :
- La cohérence interne du projet (concordance des divers moyens et instruments mobilisés pour concourir à la réalisation des objectifs)
- La cohérence externe du projet (concordance avec les actions entreprises par les autres acteurs : facultés, ONG, prestataires, …).
Efficience L’efficience étudie la relation entre les moyens mis en œuvre et leurs coûts, d’une part, et les réalisations financées, d’autre part. L’évaluation conduite par le consultant doit permettre :
- D’apprécier si les ressources nécessaires ont bien été mises en place, en temps voulu et au moindre coût ;
- D’analyser les éventuels retards et dépassements constatés.
Efficacité L’efficacité apprécie le degré de réalisation des objectifs du projet (techniques, financiers, institutionnels, etc.) ainsi que ses éventuels effets non attendus (effets positifs ou négatifs).
Elle se doit de :
- Déterminer le niveau d’atteinte des objectifs du projet en faisant ressortir les forces et les faiblesses dans les réalisations des activités de manière à permettre l’amélioration des interventions
- Mesurer le niveau d’atteinte de différents indicateurs inscrits dans le cadre logique du projet
- Examiner l’efficacité du dispositif de suivi/évaluation.
- Examiner l’efficacité du projet en appréciant la qualité technique des activités, les méthodes et les approches utilisées surtout dans le domaine de la prise en charge, la formation et la sensibilisation ;
Impact L’impact juge les retombées de l’action. Le consultant analysera ici principalement les effets immédiats sur les acteurs concernés, et notamment les bénéficiaires finaux, qui peuvent être raisonnablement attribués en partie ou en totalité à l’action évaluée. Il appréciera, le cas échéant, les perspectives d’effets de plus long terme. L’analyse devra se reporter autant que possible à des indicateurs de résultats quantifiables. Le consultant traitera pour cela l’information pertinente issue du dispositif de suivi du projet, et croisera ses données à travers une collecte de donnée in situ. Cette analyse sera complétée, le cas échéant, par une appréciation qualitative des impacts.
Viabilité/durabilité Le consultant examinera si l’atteinte des objectifs et les résultats et impacts obtenus sont de nature à se pérenniser, voire à s’amplifier, dans la durée, et si oui à quelles conditions.
DSF portera une attention particulière à la méthodologie qui sera décrite. Cette dernière doit prendre en compte les particularités et les enjeux relatifs au mode de consultation proposé (présentiel et/ou hybride). La méthodologie présentée devra s’appuyer sur un outillage et une démarche de travail appropriés aux spécificités du mode de consultation et prévoir une collaboration avec le siège et le terrain dans la construction du travail à mener.
6. Profil recherché
Les dossiers de consultants ou cabinets de consultance établis en Haïti seront privilégiés afin que l’organisation de l’évaluation sur le terrain soit facilitée.
- Formation et qualification : études supérieures en santé/sciences sociales ou politique/évaluation de programme
- Expérience professionnelle générale :
o Gestion des programmes de développement, plus particulièrement en santé est un atout
o Evaluation des programmes développement, plus particulièrement dans le domaine de la santé est un atout ;
o Connaissances et expertises techniques dans le domaine de la santé publique
- Expérience professionnel spécifique
o Connaissance du contexte haïtien
o Connaissance du système sanitaire haïtien
- Qualités requises :
o Être autonome
o Être respectueux de l’autre
o Avoir un esprit ouvert et tolérant
o Avoir de très bonnes capacités analytiques et synthétiques
o Avoir de très bonnes capacités rédactionnelles
o Être prêt à voyager et à passer des nuits sur le terrain
- Langues : français, maitrise du créole haïtien est un atout
7.Livrables attendus
- Une note de cadrage méthodologique avant la phase de collecte de données et présentation de la méthodologie (techniques et outils) proposée par le consultant doit être faite à la coordination siège, au directeur et au réfèrent technique médicale du terrain avant le début de l’évaluation ;
– Une restitution des résultats préliminaires de l’évaluation doit être prévue avec la coordination siège, le directeur et le réfèrent technique médicale du terrain à l’issue des travaux ;
– Le rapport préliminaire sera fourni 2 semaines après la fin des travaux et il sera soumis a DSF pour relecture et commentaires ;
– Le rapport définitif, intégrant les éventuelles remarques de DSF, devra être disponible dans les 7 jours suivant la réception des commentaires. Si ces observations expriment des différences d’appréciation non partagées par le consultant, celles-ci peuvent être annexées au rapport définitif et commentées par le consultant.
Le rapport final est destiné à DSF (le siège, la coordination, les gestionnaires du programme ainsi que les équipes de terrain), au bailleur et aux autorités administratives et il sera constitué de :
✓ 1 résumé exécutif (3 pages max) du rapport d’évaluation
✓ 1 rapport narratif (max 30 pages) de l’évaluation
✓ 1 tableau récapitulatif avec les principales conclusions et recommandations
✓ Les annexes techniques : contiendront les détails techniques de l’évaluation, ainsi que les termes de référence, les modèles de questionnaires, check-list et canevas d’entretiens, éventuels tableaux ou graphiques, les références et autres sources, liste des personnes et institutions contactées, la présentation Power Point des résultats.
Le rapport définitif restera la propriété de DSF qui en assurera la diffusion.
8. Modalités de sélection du consultant
| L’évaluation de la proposition fournie par le consultant se fera suivant la grille d’évaluation critériée indiquée dans le tableau ci-dessous : CRITERES DE SELECTION | PONDERATION |
| 1. Profil du consultant
| 40 |
| Qualifications, expériences, compétences | 15 |
| Expériences dans le secteur à évaluer | 15 |
| Connaissance du contexte | 10 |
| 2.Offre technique | 40 |
| Exposé de la problématique du sujet et qualité de la réponse par rapport aux termes de référence | 15 |
| Démarche méthodologique proposée | 15 |
| Calendrier de mise en œuvre | 10 |
| 3.Offre financière | 20 |
| Budget de la prestation en USD | 10 |
| Cohérence du coût par rapport à la méthodologie proposée | 10 |
| Total | 100 |
9. Modalités de candidature
Les consultants invités à soumissionner devront fournir les éléments suivants :
Une offre technique comprenant :
- Un CV comprenant des références et des expériences du consultant ;
- Une note de compréhension des termes de référence et de présentation de la méthodologie utilisée ;
- Le calendrier prévisionnel d’intervention ; La période de réalisation de l’évaluation est envisagée en avril/mai 2025.
Une offre financière comportant :
- Le budget global (Hors Taxe et Toutes Taxes Comprises) et les prix détaillés (honoraires, indemnités journalières, transports…).
Pour information : enveloppe budgétaire restreinte.
Les candidats (structures ou personnes indépendantes) intéressés pour soumissionner à cette évaluation doivent envoyer leur dossier par email à : recrutement.ht@douleurs.org. La date limite de dépôt des dossiers d’ap
[1]Consultation d’appui psychologique pour les patients en souffrance, visites à domicile de soins palliatifs pour les patients en fin de vie, traitements médicamenteux et non-médicamenteux adaptés au contexte haïtien.
Vous souhaitez déposer un appel d’offre ?
Déposez vos appels d'offres pour vos recherches de prestations visant à renforcer votre organisation, faciliter vos projets...
Déjà inscrit ?
L’ABC des prestataires
Plus de 50 prestataires référencés dans notre base !
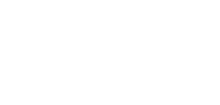
Tout chaud
L’impact concret des décisions américaines sur la solidarité internationale
Adoption du projet loi de finances pour 2025 : qu’est-ce que cela change pour la solidarité internationale ?
COMMUNIQUÉ – La pauvreté et les inégalités avancent, la France recule en matière de solidarité…