Un·e Consultant·e en cogestion d’aire protégée Nioumachoua, Parc National de Mohéli
CONTEXTE
Créée en 2001, Noé est une association d’intérêt général à but non lucratif qui a pour mission de sauvegarder la biodiversité, pour le bien-être de tous les êtres vivants, et en particulier de l’humanité. Pour cela, Noé met en oeuvre, en France et à l’international, des programmes de conservation d’espèces menacées, de gestion d’espaces naturels protégés, de restauration de la biodiversité ordinaire et des milieux naturels, de reconnexion de l’Homme à la Nature et de soutien aux activités économiques et aux organisations de la société civile favorables à la biodiversité. Pour en savoir plus : https://noe.org/
Les activités de Noé sont réparties au sein de deux pôles :
– Le Pôle National mène des programmes en France autour de quatre missions : la biodiversité agricole, la biodiversité urbaine, la biodiversité des milieux naturels ainsi que les observatoires de la biodiversité.
– Le Pôle International mène des programmes principalement en Afrique autour de quatre missions : les aires protégées, les espaces naturels, les espèces menacées, ainsi que la filière pro-biodiversité.
Etabli par décret N° 01-053/CE du Chef de l’Etat en date du 19 avril 2001, le Parc Marin de Mohéli (PMM) est la première aire protégée de l’Union des Comores. Le Parc Marin de Mohéli (PMM) devient Parc National de Mohéli (PNM) suite au nouveau décret, n° 15-188 / PR du 27 novembre 2015, avec une extension considérable des limites de l’aire protégée sur la partie terrestre de l’île de Mohéli, intégrant ainsi les forêts sèches et humides, ainsi que les bassins versants et franges littorales.Cette Aire Protégée a une superficie de 644 Km2, dont 472 Km2 pour la partie marine et 172 Km2 pour la partie terrestre. Elle abrite une biodiversité remarquable, d’une importance régionale et mondiale capitale. La partie marine du PNM est reconnue comme le secteur marin le plus riche de l’archipel des Comores. Il englobe une grande diversité d’habitats et d’espèces emblématiques, voire endémiques : récifs coralliens frangeants à forte densité de mammifères marins, bordant la côte et les îlots sur près de 4000 ha, plages sableuses, herbiers de phanérogames attirant différentes espèces de tortues, et de nombreux îlots de taille diverse. Les environnements côtiers du Parc National de Mohéli présentent une grande diversité d’habitats marins, notamment des récifs coralliens, des mangroves et des herbiers marins.
Cependant, ce riche patrimoine naturel subit des pressions, globalement anthropiques, portant atteinte aux ressources terrestres et marines de l’île. La plupart de ces pressions anthropiques sont liées à une exploitation de plus en plus importante de ces ressources combinée à des méthodes d’exploitation peu durables (prélèvement de sable, déforestation, braconnage, pêche destructrice, méthodes culturales non responsables, …). Ces pressions sont exacerbées par la hausse démographique que connaissent les Comores, dont Mohéli (la population a doublé ces 20 dernières années). Elle est évaluée à 51 230 habitants (RGPH 2017).
Le PNM est une aire protégée de catégorie VI (typologie UICN), une aire protégée avec utilisation durable des ressources naturelles au profit des communautés locales. Son mandat est de préserver les écosystèmes et des habitats ainsi que les valeurs culturelles et les systèmes traditionnels de gestion des ressources naturelles qui y sont associés. C’est pourquoi, dès sa création en 2001, le cadre de la gestion du PNM, bien stipulé dans le décret portant création de l’aire protégée, est fondé sur des accords de cogestion établis avec les communautés locales en collaboration avec les autres parties prenantes. Ces accords visent à impliquer les populations dans la gestion des ressources naturelles, en reconnaissant leur rôle essentiel dans la préservation de l’environnement tout en leur offrant des bénéfices directs. Ils permettent également de renforcer la sensibilisation et la participation communautaire dans la conservation, contribuant ainsi à une gestion plus durable et équitable des ressources marines et terrestres. D’autres parties prenantes, en l’occurrence les autorités communales et les responsables judiciaires ont également leur rôle à jouer là-dessus. Ce qui justifie l’approche participative et inclusive dans la gestion et la gouvernance du PNM. En 2002, le PNM a obtenu le prix Equator relatif à la mobilisation communautaire sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques (la cogestion).
Le programme RECOS, financé par l’Agence Française de Développement (AFD) et le Fond Français pour l’Environnement Mondial (FFEM) et coordonné par la Commission de l’Océan Indien (COI) basée à Maurice, vise à renforcer la résilience des populations littorales et des écosystèmes du Sud-Ouest de l’Océan Indien face aux effets du changement climatique en restaurant les services rendus par les écosystèmes.
Le Parc National de Mohéli a été sélectionné comme site pilote pour ce programme. Une convention tripartite entre Noé, le PNM et la COI a été établie, avec Noé comme co-coordinateur avec le PNM qui est à la fois bénéficiaire et co-porteur du projet. En ce sens, le projet RECOS Mohéli comprend donc une coordination bilatérale impliquant deux coordinateurs de projet, un membre du PNM et un membre de Noé. Le projet a débuté en janvier 2024 et sera en place jusqu’à la fin de juin 2026.
Le projet RECOS Mohéli vise à améliorer la résilience du PNM au changement climatique et la gestion durable des écosystèmes marins et côtiers pour l’amélioration des conditions économiques des communautés côtières. Pour y parvenir, les objectifs spécifiques du projet sont :
1) Conserver et restaurer les écosystèmes marins et côtiers du PNM, en particulier les mangroves et les herbiers.
2) Protéger les espèces emblématiques du parc, les tortues marines et les dugongs.
3) Améliorer les conditions économiques des populations côtières.
Sujet de l’étude : Etude de capitalisation des accords de cogestion du PNM
A. Contexte
Depuis la création du Parc National de Mohéli en 2001, des accords de cogestion ont été établis avec les communautés locales pour assurer une gestion partagée et durable de l’environnement et des ressources naturelles. Ces accords définissent les droits, responsabilités et contreparties de chaque partie impliquée à l’échelle des différents villages de l’île. En complément des textes réglementaires en vigueur sur le territoire national, ces accords sont au coeur du fonctionnement du Parc. Leur mise en place a fait figure de référence internationale en matière de gestion et gouvernance des aires protégées, par l’approche de conservation intégrante des communautés locales.
Si les effets immédiats de ces accords ont été salués dans de nombreuses publications, aucune étude approfondie n’a été menée pour évaluer leur impact sur le long terme, en particulier dans un contexte
social et environnemental en pleine mutation : croissance démographique, renforcement de la circulation entre les archipels, ouverture au commerce international, ressources naturelles plus limitées, etc.
Les 24 années d’existence des accords de cogestion se sont traduites de différentes manières pour les parties prenantes impliquées (PNM, Communautés, Organisations de la société-civile, autorités communales et responsables judiciaires). Il existe un réel besoin d’analyser de façon détaillée les forces et faiblesses de ces accords, de leur divulgation, de la communication qui les entoure, etc. en vue de formuler des recommandations pour améliorer la gestion participative des ressources naturelles au sein du PNM en vue d’une vraie acceptation sociale de l’aire protégée, de son modèle de gouvernance et de gestion.
Cette étude est prévue dans le cadre de la composante 3 du projet RECOS Mohéli, plus précisément au sein de la sous-composante 3.3, intitulée « Les communautés sont parties prenantes de la gestion et de la préservation des ressources marines ». Elle vise une capitalisation des accords de cogestion établis depuis la création du parc, dans le but de faciliter leur révision, améliorer leur efficacité, favoriser leur compréhension et tisser des solutions pour parfaire leur acceptation et leur implémentation avec et par les communautés côtières. Une telle évaluation est essentielle pour la mise en oeuvre d’une stratégie de conservation intégrante des communautés, elle servira de base pour les futures négociations, l’optimisation des mécanismes de cogestion. Enfin elle permettra de proposer des pistes de développement qui tiennent compte des besoins et des perspectives des communautés locales, notamment par rapport à l’intégration des femmes dans la préservation de l’environnement et la gestion des ressources naturelles.
B. Objectifs de l’étude
L’objectif principal de cette étude est de favoriser une capitalisation des 24 dernières années de cogestion entre le Parc National de Mohéli, les communautés locales et les autres parties prenantes afin d’évaluer :
• Ce qui a fonctionné et ce qui n’a pas fonctionné dans la mise en oeuvre de ces accords ;
• Les forces et les faiblesses des accords actuels de cogestion ;
• Le rôle et la place des femmes dans la cogestion et leur implication dans la gestion de l’environnement et des ressources naturelles.
Des pistes d’améliorations pour une cogestion plus équitable et durable, avec une attention particulière à l’intégration des femmes.
DESCRIPTION DU POSTE
Supervision hiérarchique : Sous la supervision de la direction du Parc National de Mohéli et des deux coordinateurs du projet RECOS Mohéli : Mouchtadi Madi Bamdou (PNM) et Germain Therre (Noé)
Principales responsabilités et activités :
1) Définir des outils d’enquête pertinents (éventuellement axés autour de questions transverses) :
Collaborer étroitement avec la direction du Parc National de Mohéli et les coordinateurs du projet RECOS pour définir des outils de collecte de données intégrant
(i) Les enjeux de cogestion,
(ii) La conservation communautaire dans un cadre de développement économique et
(iii) Des aspects concrets de la conservation de l’environnement (surveillance et suivi des infractions, sanctions, droits, responsabilités et contreparties des parties prenantes, etc.). Ces outils devront s’intégrer dans le cadre de l’évaluation des accords de cogestion mis en place depuis 24 ans avec les communautés locales. Ils devront intégrer des aspects particuliers permettant d’établir un diagnostic efficace et réaliste sur le genre.
2) Revue bibliographique :
Effectuer une revue de littérature sur la cogestion et son efficacité dans la gestion des aires protégées à l’échelle locale, nationale, régionale et internationale. Une attention particulière sera donnée aux apports de l’étude et des actions des projets Swiofish 1 et du projet résilience de la sécurité alimentaire à Moheli. La bibliographie devra aborder les enjeux de la conservation des accords de cogestion et des impacts socio-économiques et écologiques.
3) Identifier des acteurs clés de la cogestion :
En concertation avec les responsables du PNM, de la direction régionale de la pêche et de Noé, sélectionner des zones d’étude villages pertinentes et des accords de cogestion particuliers à analyser. Identifier les acteurs impliqués dans ces accords (associations communautaires, membres du Parc, pêcheurs, etc.) et les différentes parties prenantes à la cogestion.
4) Définir le protocole d’enquête :
Le questionnaire sera réalisé avec la supervision du Parc National de Mohéli et Noé, il devra permettre d’évaluer l’efficacité des accords de cogestion sur le long terme, les dynamiques environnementales, sociales et économiques associées, ainsi que les attentes actuelles des communautés et autres parties prenantes, principalement les communes. Une attention particulière sera portée à l’inclusion des femmes et à l’évolution des besoins des communautés. Un protocole d’échantillonnage des populations interrogées sera également défini.
5) Mise en oeuvre de l’enquête :
L’enquête sera menée sur le terrain en suivant le protocole de sondage établi. Elle impliquera la collecte de données auprès des communautés et des acteurs clés identifiés, afin de garantir une représentation fidèle des perceptions et des enjeux liés à la cogestion du parc.
6) Traitement et analyse des données : Analyser les données recueillies grâce aux questionnaires et aux entretiens afin de répondre aux objectifs de l’étude.
7) Rédaction d’un rapport de capitalisation :
Rédiger un rapport de capitalisation qui intègrera les analyses réalisées à partir des enquêtes ainsi qu’un diagnostic genre. Le rapport devra permettre de répondre aux objectifs de l’étude (recommandations pour améliorer l’implémentation des accords de cogestion, renforcer l’intégration des communautés locales dans la préservation de leur environnement, améliorer les impacts des accords, etc.) avec un accent particulier sur l’inclusion des femmes.
A. Résultats / Livrables attendus
Les résultats attendus de la mission de l’expert.e incluront :
1) Un rapport détaillé sur l’évaluation des accords de cogestion depuis la création du Parc, comprenant : • Une analyse approfondie des résultats des accords de cogestion, mettant en lumière les succès, les défis, les problématiques et leur impact sur les communautés locales ainsi que sur l’environnement.
• Des recommandations concrètes centrées sur les actions concrètes pour renforcer la participation des communautés au travers des accords qui pourront comprendre (liste non exhaustive) : harmonisation des accords, prise en compte des menaces récentes sur l’environnement
• Des propositions réalistes et pratiques visant à améliorer la communication et les interactions entre le Parc National de Mohéli, es communautés locales et les autres parties prenantes autour des accords de cogestion.
• Des recommandations spécifiques sur la révision des accords de cogestion, précisant les éléments à prendre en compte, les écueils à éviter et les étapes méthodologiques à suivre pour une révision efficace et adaptée aux enjeux actuels.
• Des recommandations pratiques à destination du PNM et de Noé quant aux modes de divulgation des accords, à leur accessibilité au sein des communautés et des autres parties prenantes (communes et justice par exemple), à leur affichage, à leur explication ou à l’organisation de réunion de sensibilisation sont attendues (liste non exhaustive).
2) Un diagnostic genre :
• Une évaluation de la participation des femmes aux accords de cogestion, en analysant leur rôle actuel dans la prise de décision et la gestion des ressources naturelles.
• Des recommandations pour mieux intégrer les femmes, incluant des actions spécifiques afin d’augmenter leur implication dans les processus de cogestion et dans les initiatives communautaires liées à la préservation de l’environnement et la gestion durable des ressources naturelles.
3) Propositions méthodologiques attendues (liste non exhaustive) :
• Observation participante ;
• Jeux sérieux ;
• Entretiens semi-directifs avec des membres des communautés et des autorités communales ;
• Focus groups avec des groupements villageois et des OSC directement affectées par les accords de cogestion ;
• Entretiens semi-directifs avec le PNM (Direction, responsable de la sécurité, responsable communautaire) et travailleurs de l’association Noé, partenaire du PNM dans le cadre de RECOS.
PROFIL RECHERCHE
Expérience :
• Expérience avérée en évaluation de projets communautaires et en analyse des dynamiques sociales et environnementales ou expérience avérée (+5ans) dans la mise en place de projet de conservation communautaire dans un contexte similaire à celui du PNM.
• Expérience préalable de terrain dans une région insulaire (idéalement Océan Indien) souhaitée.
• Langue de travail : Français. Connaissance du shikomori appréciée.
Formation :
• Expert.e en sociologie, gestion communautaire, conservation de l’environnement, gestion environnementale, anthropologie ou discipline connexe.
Compétences et qualités :
• Compétences en diagnostic genre et inclusion sociale.
• Excellentes capacités d’analyse et de synthèse, avec une aptitude à rédiger des rapports clairs et structurés.
• Connaissance du contexte des aires protégées de catégorie VI de l’UICN
COMMENT POSTULER
Merci d’adresser par courrier électronique au plus tard le 16/04/2025, aux adresses suivantes gtherre@noe.org / mouchtadimadi@yahoo.fr
• Une offre technique incluant :
o Un CV détaillé, mettant en avant les expériences pertinentes et les compétences techniques en lien avec les domaines spécifiques de la mission.
o La compréhension du contexte et des objectifs de la mission (1 page maximum) ainsi qu’un document détaillant la méthodologie de travail et stratégie de terrain, déployée (1 page maximum).
o Un planning indicatif de la mission mis à jour selon les besoins de l’expert, comprenant une estimation du temps nécessaire pour mener à bien les différentes étapes de la mission.
• Une offre financière incluant les honoraires de mission, journaliers ou mensuels.
En indiquant dans l’objet du mail « Cogestion RECOS Moheli ».
Les candidats sont encouragés à fournir des informations complémentaires qui pourraient être pertinentes pour évaluer leur aptitude à remplir les objectifs de la mission.
La méthode de sélection du candidat sera celle fondée sur l’analyse de la qualité-coût, au regard du profil demandé. Le PNM et Noé se réservent le droit de négocier les propositions reçues.
Noé accorde une grande importance à la protection des données personnelles de ses membres et candidats. Les informations collectées lors des candidatures sont strictement transmises aux intervenants du processus de recrutement, indépendamment de la localisation au sein de la structure Noé, assurant un traitement équitable et de qualité.
Vous souhaitez déposer un appel d’offre ?
Déposez vos appels d'offres pour vos recherches de prestations visant à renforcer votre organisation, faciliter vos projets...
Déjà inscrit ?
L’ABC des prestataires
Plus de 50 prestataires référencés dans notre base !
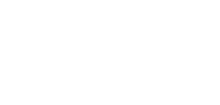
Tout chaud
L’impact concret des décisions américaines sur la solidarité internationale
Adoption du projet loi de finances pour 2025 : qu’est-ce que cela change pour la solidarité internationale ?
COMMUNIQUÉ – La pauvreté et les inégalités avancent, la France recule en matière de solidarité…